 On ne peut pas dire que Richard Gilly aura saturé notre environnement musical en un demi-siècle. Ce longiligne jeune septuagénaire, homme sensible et musicien discret, nous livre en 2022 un huitième album, Mémoire vive. Celui qui, à l’aube des années 70, reconnaissait ne pas être un grand fermier n’en était pas moins un arboriste méticuleux de l’amour et des confidences faites au creux de l’oreille, dans la découverte du corps de l’être aimé. Cet homme-là est assurément toujours présent, préservé des vulgarités de l’existence et aimant comme au premier jour. Mais cinquante ans plus tard, le monde a continué de tourner, pris dans le tourbillon implacable de ses folies planétaires et de la cruauté insatiable des hommes. Oui, le monde a tourné, et bien mal. Restent néanmoins comme ultime bouclier les sentiments qu’on éprouve et offre à l’autre pour les déposer avec toute la délicatesse qu’impose une vie digne de ce nom. On pourrait trouver tout cela naïf, alors qu'il s'agit simplement de se présenter en être humain.
On ne peut pas dire que Richard Gilly aura saturé notre environnement musical en un demi-siècle. Ce longiligne jeune septuagénaire, homme sensible et musicien discret, nous livre en 2022 un huitième album, Mémoire vive. Celui qui, à l’aube des années 70, reconnaissait ne pas être un grand fermier n’en était pas moins un arboriste méticuleux de l’amour et des confidences faites au creux de l’oreille, dans la découverte du corps de l’être aimé. Cet homme-là est assurément toujours présent, préservé des vulgarités de l’existence et aimant comme au premier jour. Mais cinquante ans plus tard, le monde a continué de tourner, pris dans le tourbillon implacable de ses folies planétaires et de la cruauté insatiable des hommes. Oui, le monde a tourné, et bien mal. Restent néanmoins comme ultime bouclier les sentiments qu’on éprouve et offre à l’autre pour les déposer avec toute la délicatesse qu’impose une vie digne de ce nom. On pourrait trouver tout cela naïf, alors qu'il s'agit simplement de se présenter en être humain.
En douze chansons courtes, Richard Gilly écrit un manifeste pour la Vie, sans élever la voix, avec ce minimalisme qui le caractérise depuis toujours. Chaque note compte, chaque parole est habitée. Sa « Mémoire vive » saigne des violences imposées par le terrorisme et les dictatures, ses « Bleus » ne sont pas des mots – même si un clin d’œil en forme de paradis perdus évoque ceux d’une autre chanson – mais sont imprimés sur les visages des femmes battues. Le temps qui passe, la mort qui vient (« Au large de Véga »), les injustices de la naissance (« Par la main que tu tends »), les innocents assassinés en masse (« Sans un cri »), l’exil des « Migrants » sont autant d’invocations qui nourrissent la poignante prière d’un homme pourtant non croyant (« Si t’es là-haut »).
Comme à chaque rendez-vous avec ce chanteur bien trop rare, on entre à pas feutrés dans un clair-obscur existentiel. Parce que si les ténèbres contemporaines ont beau être chez lui la source d’un cri douloureux impossible à contenir, l’amour reste le trésor fragile qu’il faut préserver coûte que coûte, même sous le froid d’une pluie de « Septembre ». On en découvre le frémissement dans la lumière d’un matin pâle (« Les yeux ouverts ») et l’ivresse de l’oubli (« Je veux me perdre »), pour toujours (« Ad Vitam Aeternam »).
Parfois, les mots s’effacent et vient un « Piano de mars », courte parenthèse instrumentale aux intonations « ambient » que ne renierait pas un Brian Eno.
Une guitare, un clavier, un frisson de cordes ou quelques percussions de velours. Une voix qui chante et parle tout autant, retenue par ce qu’on devine être la pudeur d’un homme conscient. Mémoire vive, arrangé et réalisé par Hervé Le Duc, est un disque qui va à l’essentiel, sans artifice mais avec beaucoup de justesse. Ainsi est Richard Gilly, témoin de nos tourments, artiste différent. De ceux dont on se dit, aussi, qu’ils sont des compagnons de vie.
Musiciens : Richard Gilly (chant, guitare) ; Hervé Le Duc (claviers, programmation, arrangements et réalisation).
Titres : Septembre (3:00) | Mémoire vive (3:17) | Bleus (2:01) | Au large de Véga (3:21) |Si t’es là-haut (2:55) | Par la main que tu tends (3:17) | Ad Vitam Aeternam (4:22) | Piano de mars (3:10) | Les yeux ouverts (3:05) | Sans un cri (2:12) | Migrants (2:34) | Je veux me perdre (1:58).
Label : Autoproduction (1er avril 2022)
Rappel : la discographie de Richard Gilly
Je ne suis pas un grand fermier (1971), Les froides saisons (1975), Portrait de famille (1977), Râleur (1984), Rêves d'éléphant (1993), Des années d'ordinaire (2002), Les contes de la piscine après la pluie (2015), Mémoire vive (2022).
 L’idée trottait dans la tête de Lionel Belmondo depuis une quinzaine d’années. Lui, le musicien passeur, capable d’unir dans un même idiome des univers d’esthétiques très différentes – tels ceux de Lili Boulanger, Claude Debussy, John Coltrane ou Milton Nascimento – était habité du désir de célébrer la musique d’un groupe californien désormais mythique : The Grateful Dead. En écho au souvenir de tant d’excès psychotropes, des images kaléidoscopiques surgissent, réactivant la mémoire de concerts marathons où l’improvisation avait droit de cité dans un langage mêlant rock, folk, blues, country ou bluegrass. Les mélodies de Jerry Garcia sur les textes à forte teneur poétique de Robert Hunter ont porté pendant trente ans un groupe dont l’existence cessera au moment de la mort de son leader en 1995. Fort judicieusement, le répertoire ici sélectionné fait appel aux dix années les plus créatives de l’aventure et c’est un groupe très motivé qui célèbre avec beaucoup d’à-propos, conservant toutes les trames mélodiques en les parant de couleurs actuelles. Dead Jazz Plays the Music of the Grateful Dead est bien plus qu’un hommage : c’est une déclaration d’amour, dont le sommet est « Blues For Allah » qui épaissit encore le mystère de la version originale.
L’idée trottait dans la tête de Lionel Belmondo depuis une quinzaine d’années. Lui, le musicien passeur, capable d’unir dans un même idiome des univers d’esthétiques très différentes – tels ceux de Lili Boulanger, Claude Debussy, John Coltrane ou Milton Nascimento – était habité du désir de célébrer la musique d’un groupe californien désormais mythique : The Grateful Dead. En écho au souvenir de tant d’excès psychotropes, des images kaléidoscopiques surgissent, réactivant la mémoire de concerts marathons où l’improvisation avait droit de cité dans un langage mêlant rock, folk, blues, country ou bluegrass. Les mélodies de Jerry Garcia sur les textes à forte teneur poétique de Robert Hunter ont porté pendant trente ans un groupe dont l’existence cessera au moment de la mort de son leader en 1995. Fort judicieusement, le répertoire ici sélectionné fait appel aux dix années les plus créatives de l’aventure et c’est un groupe très motivé qui célèbre avec beaucoup d’à-propos, conservant toutes les trames mélodiques en les parant de couleurs actuelles. Dead Jazz Plays the Music of the Grateful Dead est bien plus qu’un hommage : c’est une déclaration d’amour, dont le sommet est « Blues For Allah » qui épaissit encore le mystère de la version originale. Loin du crépusculaire
Loin du crépusculaire  On ne peut pas dire que Richard Gilly aura saturé notre environnement musical en un demi-siècle. Ce longiligne jeune septuagénaire, homme sensible et musicien discret, nous livre en 2022 un huitième album, Mémoire vive. Celui qui, à l’aube des années 70, reconnaissait ne pas être un grand fermier n’en était pas moins un arboriste méticuleux de l’amour et des confidences faites au creux de l’oreille, dans la découverte du corps de l’être aimé. Cet homme-là est assurément toujours présent, préservé des vulgarités de l’existence et aimant comme au premier jour. Mais cinquante ans plus tard, le monde a continué de tourner, pris dans le tourbillon implacable de ses folies planétaires et de la cruauté insatiable des hommes. Oui, le monde a tourné, et bien mal. Restent néanmoins comme ultime bouclier les sentiments qu’on éprouve et offre à l’autre pour les déposer avec toute la délicatesse qu’impose une vie digne de ce nom. On pourrait trouver tout cela naïf, alors qu'il s'agit simplement de se présenter en être humain.
On ne peut pas dire que Richard Gilly aura saturé notre environnement musical en un demi-siècle. Ce longiligne jeune septuagénaire, homme sensible et musicien discret, nous livre en 2022 un huitième album, Mémoire vive. Celui qui, à l’aube des années 70, reconnaissait ne pas être un grand fermier n’en était pas moins un arboriste méticuleux de l’amour et des confidences faites au creux de l’oreille, dans la découverte du corps de l’être aimé. Cet homme-là est assurément toujours présent, préservé des vulgarités de l’existence et aimant comme au premier jour. Mais cinquante ans plus tard, le monde a continué de tourner, pris dans le tourbillon implacable de ses folies planétaires et de la cruauté insatiable des hommes. Oui, le monde a tourné, et bien mal. Restent néanmoins comme ultime bouclier les sentiments qu’on éprouve et offre à l’autre pour les déposer avec toute la délicatesse qu’impose une vie digne de ce nom. On pourrait trouver tout cela naïf, alors qu'il s'agit simplement de se présenter en être humain. L’un de mes camarades du magazine Citizen Jazz ayant préempté la chronique de ce disque avant même que j’aie eu le temps de cocher la case correspondante dans le grand tableau où s’affichent les nouveautés dont il faut rendre compte, me voici dans la douce obligation d’évoquer ici le plaisir d’écoute qu’a suscité instantanément chez moi cette nouvelle aventure discographique signée Daniel Erdmann et Christophe Marguet. Le saxophoniste et le batteur n’en sont pas à leur coup d’essai, loin de là. On se souviendra que leur collaboration remonte à une douzaine d’années et que c’est en 2014 qu’ils ont publié un magnifique disque en duo,
L’un de mes camarades du magazine Citizen Jazz ayant préempté la chronique de ce disque avant même que j’aie eu le temps de cocher la case correspondante dans le grand tableau où s’affichent les nouveautés dont il faut rendre compte, me voici dans la douce obligation d’évoquer ici le plaisir d’écoute qu’a suscité instantanément chez moi cette nouvelle aventure discographique signée Daniel Erdmann et Christophe Marguet. Le saxophoniste et le batteur n’en sont pas à leur coup d’essai, loin de là. On se souviendra que leur collaboration remonte à une douzaine d’années et que c’est en 2014 qu’ils ont publié un magnifique disque en duo, 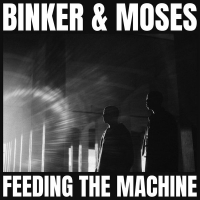 Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Feeding the Machine, cinquième album du duo britannique formé par le saxophoniste Binker Golding et le batteur Moses Boyd.
Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Feeding the Machine, cinquième album du duo britannique formé par le saxophoniste Binker Golding et le batteur Moses Boyd. Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Back to Heaven, la seconde incursion de Franck Tortiller et son orchestre au pays de Led Zeppelin.
Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Back to Heaven, la seconde incursion de Franck Tortiller et son orchestre au pays de Led Zeppelin.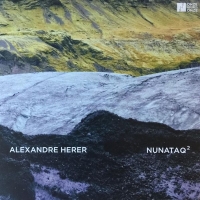 Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Nunataq 2, le nouveau disque d'Alexandre Herer en action avec son Fender Rhodes et son trio.
Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Nunataq 2, le nouveau disque d'Alexandre Herer en action avec son Fender Rhodes et son trio. Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Tissé, le nouveau disque de Marion Rampal en toute complicité avec le guitariste Matthis Pascaud et quelques ami.e.s.
Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Tissé, le nouveau disque de Marion Rampal en toute complicité avec le guitariste Matthis Pascaud et quelques ami.e.s. Du côté de chez Citizen Jazz, publication de The Montreux Years, une compilation sélection d'enregistrements live effectuée par le guitariste John McLaughlin après ses différents passages au Festival de Montreux entre 1978 et 2016.
Du côté de chez Citizen Jazz, publication de The Montreux Years, une compilation sélection d'enregistrements live effectuée par le guitariste John McLaughlin après ses différents passages au Festival de Montreux entre 1978 et 2016. Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Ça qui est merveilleux, une nouvelle collaboration entre la pianiste Françoise Toullec et sa complice chanteuse récitante Dominique Fonfrède.
Du côté de chez Citizen Jazz, publication de Ça qui est merveilleux, une nouvelle collaboration entre la pianiste Françoise Toullec et sa complice chanteuse récitante Dominique Fonfrède.